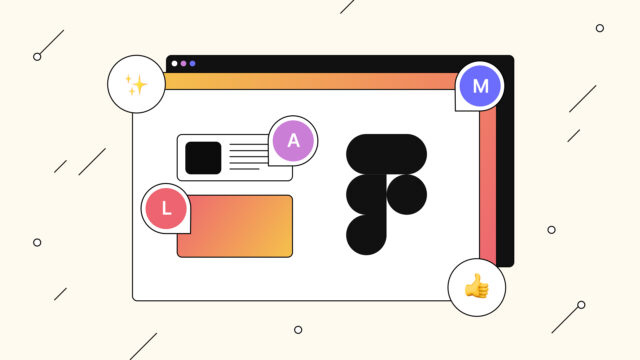Retour d’expérience sur l’organisation d’ateliers de co-conception
Stagiaire en UX design dans le cadre d’une reconversion professionnelle, j’ai eu la chance de pouvoir organiser des ateliers de co-conception pour un gros projet de refonte de site chez Digital Ping Pong. Je vous partage ici mon retour d’expérience.
La réalisation de ces ateliers s’est déroulée en plusieurs étapes :
1. La recherche de jeux pour les ateliers
Nous sommes chanceux, nous, designers en manque d’inspiration, le web regorge d’idées de jeux. Évidemment, la majeure partie des ressources disponibles est en anglais. Ce qu’on trouve en plus grande quantité, pas de chance, ce sont des ice-breakers. Je dis “pas de chance”, car chez Digital Ping Pong, nous avons réalisé ces ateliers avec des clients que nous connaissons bien, puisqu’ils nous avaient déjà confié d’autres projets par le passé. Je n’avais donc pas besoin d’ice-breaker. Entre “acheter une fonctionnalité”, “world’s worst”, “sketch storming” et bien d’autres, de nombreux jeux d’ateliers donnent une belle piste pour le départ, et permettent de changer du traditionnel tri de cartes (bien qu’indispensable et efficient dans de nombreuses situations).
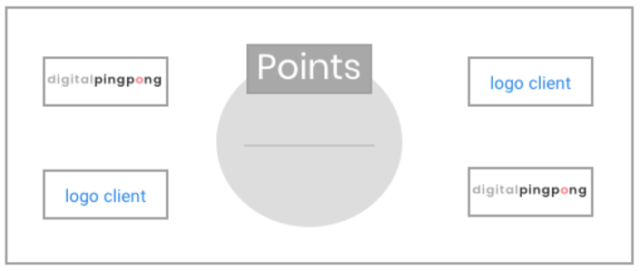
2. Adapter les ressources en fonction des besoins et des clients
Je pense notamment au jeu “acheter une fonctionnalité”. L’idée dans cet atelier est d’avoir à sa disposition une somme d’argent fictive dont on se sert pour acheter des fonctionnalités définies en amont. Le but est de distinguer quelles sont les fonctionnalités à prioriser pour l’utilisateur.Si en théorie tout devrait bien se passer, il est difficile de parler achat de fonctionnalité avec certains clients, qui pourraient penser qu’on va leur demander de nous signer un chèque en sortie d’atelier. Nous avons donc pris la décision de conserver l’idée du jeu, mais en ne proposant plus de l’argent fictif, mais une cagnotte de points.
Oui, cela revient strictement au même, mais éviter de froisser les clients permet aussi de se concentrer sur l’essentiel et de ne pas perdre de temps à expliquer que non, on ne vous demandera pas de budget supplémentaire.

3. Préparer l’atelier
Une fois qu’on a choisi ou créé ses jeux, l’idée est de rendre aussi ludique que possible le déroulement de l’atelier. Pour ce faire, on prépare par exemple des supports comme des billets pour le jeu “acheter une fonctionnalité” (avec des points, donc). J’ai personnellement choisi de créer les kits de jeu sur Sketch. En groupant les éléments dans des symboles, on peut les réutiliser et les adapter si on a besoin du même jeu dans d’autres circonstances. Pour des exercices de sketch storming, on peut prévoir des feuilles à points pour “guider” le crayon des participants à l’atelier, par exemple.

4. L’atelier
Idéalement, avoir un facilitateur et un observateur qui prend des notes est le combo gagnant. De cette façon, le facilitateur peut vraiment se concentrer sur l’animation pendant que l’observateur scrute et note ce qu’il voit et entend. On est d’accord, ça, c’est dans un monde idéal. En réalité, le facilitateur s’occupe généralement de tout gérer. J’ai eu de la chance sur ces ateliers, tous les participants ont joué le jeu, étaient impliqués et positifs. Ce qui m’a frappé aussi, c’est que ce ne sont pas forcément les jeux qui ont demandé le plus de préparation qui sont le plus productifs. L’activité qui fait l’unanimité c’est de sketcher, puis de coller des gommettes sur les éléments des autres participants qu’ils ont trouvé pertinents (système de vote).

5. le ROTI
Ou Return On Time Invested. Là le but est de connaître le ressenti des participants. Les candidats de l’atelier ont rendu leur verdict, et la sentence est irrévocable. On demande aux participants de noter l’atelier entre 1 et 5 (1 j’ai perdu mon temps, 5 c’était vraiment génial, j’ai vraiment l’impression d’avoir fait avancer les choses).
Le ressenti est vraiment positif à chaque fois, avec des notes entre 4 et 5.
En conclusion
L’atelier de co-construction est, selon moi, un moyen vraiment efficace pour connaître les vraies attentes des utilisateurs, les prioriser. Cela permet aussi d’affiner les besoins, notamment lorsque tout n’est pas clair lors du brief. Je reste bluffée par la richesse des informations qui ressortent de ces ateliers.
A lire également
La qualité des livrables UX/UI dans un projet web
Méthodologie • UI Design • UX Design • ProtipsLire l’articleQu’est-ce qu’un livrable ? Un livrable est un élément spécifique à “livrer” à une date donnée lors d’un projet (audit,
Comment élaborer sa stratégie de contenu pour sa newsletter ?
MéthodologieLire l’articleLa création d’une newsletter est un excellent moyen de tenir ses clients et prospects informés des actualités, des événements et